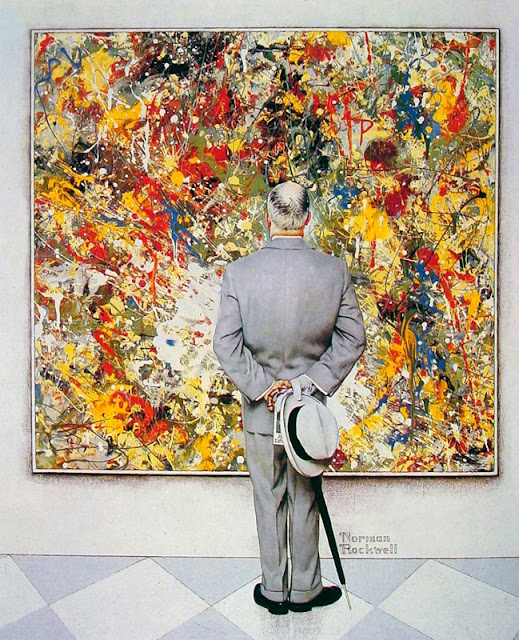Le mystère des cavernes
Depuis la découverte de peintures d’animaux au plafond de la grotte d’Altamira, en 1879, et leur attribution à des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, on ne cesse de s’interroger sur la raison d’être de ces images.
Pourquoi des humains se sont-ils donnés la peine d’aller peindre ces figures au fond de grottes difficilement accessibles, éclairés par la seule lueur vacillante de torches enduites de résine ou de lampes à graisse ?
Et comment sont-ils parvenus à ce style figuratif remarquable qui a perduré près de vingt millénaires ?
Pour répondre à la question du "comment", Bertrand David, un illustrateur passionné de préhistoire, a échafaudé, en 2013, une hypothèse astucieuse connue sous le nom de théorie des ombres.
L’idée lui en est venue en remarquant l’ombre d’une figurine de dinosaure projetée par une lampe de chevet sur le mur de la chambre de son fils. Il a alors entrepris d’en détourer le profil sur une feuille de papier à l’aide d’un fusain.
L’idée lui en est venue en remarquant l’ombre d’une figurine de dinosaure projetée par une lampe de chevet sur le mur de la chambre de son fils. Il a alors entrepris d’en détourer le profil sur une feuille de papier à l’aide d’un fusain.
L'idée n'était pas nouvelle. C'était même, selon Pline l’Ancien, ainsi que serait née la peinture : la
fille d’un potier de Corinthe, Callirrhoé de Sicyone, aurait eu l’idée
de tracer sur un mur le contour de l’ombre de son amant pour en conserver l’image après son départ.
Mais c'était la première fois qu'on pensait à attribuer cette technique aux plus anciennes images connues produites par homo sapiens.
Le résultat de ses essais à confirmé son intuition. Le style des dessins obtenus ressemblait étonnamment à celui des images retrouvées au fond des cavernes. Même des personnes n'ayant jamais manié le crayon obtenaient, avec cette technique, une qualité de tracé inattendue.
Et puisque, à défaut de dinosaure jouet, on retrouve fréquemment, sur le sol des grottes ornées, de petites statuettes sculptées qui auraient pu servir à produire les ombres portées, il tenait une réponse à sa question.
 |
| Figurine de cheval, grotte de Vogelherd, vers - 32 000. Panneau des chevaux, grotte Chauvet, vers - 35 000. |
Avec cette explication, plus besoin d’imaginer de longues séances d’apprentissage du dessin, ni de transmission de ce savoir à des groupes humains parfois fort éloignés les uns des autres, et cela durant des centaines de générations. Lorsqu’on connaissait la technique, tout un chacun pouvait réaliser les merveilles que l’on trouve dans les grottes ornées.
Même les tracés superposés de certains motifs pouvaient s’expliquer par le vacillement de la flamme de la lampe ou de la torche utilisée…
Même les tracés superposés de certains motifs pouvaient s’expliquer par le vacillement de la flamme de la lampe ou de la torche utilisée…
L’idée était belle et connut un certain succès éditorial. D’autant plus qu’elle résonnait lointainement avec la fameuse allégorie de la caverne de Platon où le monde que nous percevons n’est qu’apparence – comme des ombres projetées au fond d’une caverne dans laquelle les humains seraient enfermés.
Hélas, plusieurs éléments, qui n’avaient pas été pris en compte, invalident la théorie des ombres.
En effet, les parois des grottes ornées ne sont pas des surfaces planes comme les murs d'un musée, contrairement à ce que les reproductions dans les livres nous incitent à penser. Elles présentent de nombreux reliefs qui, dans la plupart des cas, auraient déformé ou rendu impossible les projections. De plus, les emplacements où se trouvent ces images ne possèdent que rarement le recul nécessaire au système de projection, comme c'est, par exemple, le cas avec le "cheval renversé" de Lascaux. Enfin, on n’a retrouvé, dans les salles ornées, aucune figurine dont l'ombre portée aurait pu correspondre aux silhouettes dessinées sur les parois...
En effet, les parois des grottes ornées ne sont pas des surfaces planes comme les murs d'un musée, contrairement à ce que les reproductions dans les livres nous incitent à penser. Elles présentent de nombreux reliefs qui, dans la plupart des cas, auraient déformé ou rendu impossible les projections. De plus, les emplacements où se trouvent ces images ne possèdent que rarement le recul nécessaire au système de projection, comme c'est, par exemple, le cas avec le "cheval renversé" de Lascaux. Enfin, on n’a retrouvé, dans les salles ornées, aucune figurine dont l'ombre portée aurait pu correspondre aux silhouettes dessinées sur les parois...
*
Cependant, la théorie des ombres met en évidence un élément décisif. Les animaux représentés sur les parois des grottes n’ont pas été dessinés sans modèle. Ils ont bien été "décalqués". Non pas en traçant les contours d’une ombre portée, mais en suivant ceux que l’esprit projette sur les reliefs et aspérités des parois.
C’est l’hypothèse que le neurophysiologiste Alain Berthoz propose dans son livre Le sens du mouvement.
Reconnaître une forme signifiante dans un ensemble de formes aléatoires, comme un paysage dans les veines d’une pierre ou un visage dans les contours d’un nuage, est un phénomène connu. Les lettrés chinois collectionnaient les "pierres de rêve". Et, dans leurs écrits, Léonard de Vinci et Sandro Botticelli le prescrivent comme méthode créative.
Ce phénomène s'appelle la paréidolie. C'est une caractéristique de l’esprit humain qui ne peut s’empêcher d’attribuer du sens à tout ce qu’il perçoit.
 |
| Visages émergeant de la roche dont les traits ont été soulignés de noir, grotte d'Altamira, vers - 15 000. |
La variété des formes et des textures présentes dans les grottes, associée à leur découverte à la lueur dansante d'une flamme, fournit une matière exceptionnelle pour stimuler l’imagination. Un renflement de la roche suggère le mufle d’un auroch, une courbe de la paroi le dos d'un bison, une tache l'œil d'un rhinocéros, et cela suffit, explique Alain Berthoz, pour que "des réseaux neuronaux de type auto-associatifs" reconstituent l'ensemble de l'animal.
La preuve de la puissance de ce phénomène est d’ailleurs fournie par des "pariétalistes" aguerris qui, fréquemment, croient apercevoir des images à des emplacements où des examens plus approfondis montrent qu'il n'y a que des formes aléatoires.
Quand à l'expressivité et à la justesse des dessins et des peintures, elles résident dans le fait que l'image des animaux était d’autant plus saillante dans l’esprit des dessinateurs qu’ils les côtoyaient au quotidien et que leur survie dépendait grandement de la connaissance de leur comportement.
 |
| Plafond de la grotte d'Altamira, vers - 15 000. |
Voilà
qui explique en grande partie la qualité visuelle des peintures
pariétales. Nul besoin, donc, de recourir à d'hypothétiques dispositifs
d'ombres projetées. Ni, non plus, de faire appel au talent extrêmement rare de
certains enfants autistes capables de dessiner de mémoire des animaux
après les avoir vus seulement quelques minutes, comme cela a été
récemment proposé par une équipe d'universitaires anglais.
La richesse
des surfaces et le vacillement des flammes suffisent à faire surgir, sur les parois, les images qui peuplent l'esprit des visiteurs des cavernes. Il ne leur reste plus, alors, qu'à compléter les indices qu'ils détectent pour les fixer sur la roche.
*
Quant au "pourquoi" de ces images, depuis un siècle et demi, quantité d’explications ont été proposées et, tour à tour, contestées ou réfutées.
La toute première, au début du vingtième siècle, était celle de "l'art pour l'art", ce qui amena un archéologue à qualifier la grotte d'Altamira de "Chapelle Sixtine de l'ère quaternaire". Cependant, étant
donné les difficultés, parfois extrêmes, pour accéder aux emplacements où se trouvent certaines images et y
amener le matériel nécessaire pour l’éclairage et leur réalisation, il est vite apparu que le plaisir de la
création ne pouvait seul suffire à motiver le choix de ces endroits.
D'autant qu’il était parfaitement possible
de réaliser des images dans des conditions bien plus aisées sur des parois en plein air ou des abris sous roche. Ce que les humains du paléolithique supérieur ne se sont d'ailleurs pas privés de faire.
On a ensuite voulu voir dans ces images des rituels magiques destinés à favoriser la chasse ou à en expliquer les techniques. Mais le fait que les restes d'animaux consommés ne correspondent que rarement à ceux dessinés a très rapidement invalidé cette théorie.
D'autres interprétations s'inspirent des pratiques des chasseurs-cueilleurs du vingtième siècle. Le totémisme, tout d'abord, dans lequel chaque clan se définit par rapport à un animal tutélaire. Ou le chamanisme, qui fait d'un personnage initié l'intercesseur avec le monde des esprits – comme cela serait le cas pour le curieux personnage hybride découvert dans la grotte des Trois-Frères.
Pourtant, aucune de ces interprétations ne donne pleinement satisfaction.
Parce que les références ethnologiques sont approximatives, voire erronées : les animaux-totems correspondent à un caractère supposé et non à une créature réelle, quant aux chamanes, ils chantent, dansent, battent du tambour, mais ne peignent pas.
Mais l'argument majeur réside dans le fait que la diversité des images, et celle de leurs emplacements, interdit de leur trouver une seule et unique raison d'être.
Ce qui n'exclut pas, pour quelques cas spécifiques, la validité de certaines explications.
Rien n'interdit que des enfants ou des adultes autistes soient les auteurs, ici ou là, de dessins ou de peintures... Des salles au sol foulé par de nombreux pas ont très bien pu être le cadre de cérémonies rituelles... La sonorité spéciale de lieux particuliers a peut-être privilégié leur choix pour la réalisation d'images... La raréfaction en oxygène dans certains boyaux a pu être recherchée pour ses capacités hallucinogènes...
Mais l'actuel état des connaissances recueillies par des moyens scientifiques de plus en plus sophistiqués rendent peu probables des explications autres que partielles.
| * |
Parmi celles-ci, il en est une particulièrement intéressante car elle croise plusieurs domaines d'investigation. Il s'agit de la théorie de l'émergence primordiale avancée par le préhistorien et anthropologue Jean-Loïc Le Quellec.
En comparant les thèmes sous-jacents à plusieurs milliers de mythes, et en recoupant ces données avec celles de la phylogénétique qui analyse les migrations humaines grâce au décryptage de l'ADN, il a pu reconstituer l’arbre généalogique des mythes, ce qui lui a permis de découvrir que le plus ancien d’entre eux était probablement celui de l’émergence.
 |
| En rouge, répartition mondiale du mythe de l'émergence, J-L Le Quellec. |
Dans ce récit, encore vivace dans de nombreuses régions du monde, il est dit que les créatures animales vivaient autrefois sous terre et que certaines d'entre elles, dont les humains, ont fini par accéder à la surface. Un mouvement qui n’est pas définitivement achevé et que certains rituels permettent d’entretenir. Cela pourrait constituer la raison pour laquelle les chasseurs-cueilleurs du paléolithique supérieur auraient dessiné et peint des animaux au fond des cavernes, dans le but de célébrer et entretenir le mouvement d'émergence là où il est supposé se manifester.
Cette théorie a l'avantage d'expliquer le fait que les peintures figuratives représentent de manière quasiment exclusive des animaux. Cela justifie également qu'elles soient souvent situées dans des endroits inaccessibles : elles ne sont pas destinées à être vues par les humains, elles s'adressent aux esprits qui retiennent les animaux sous terre et leur permettent, parfois, de rejoindre la surface.
*
Lorsqu’on rapproche la théorie de l’émergence et l’hypothèse de la paréidolie, on s’aperçoit que le « pourquoi » et le « comment » des peintures pariétales s’accordent parfaitement.
En effet, les chasseurs-cueilleurs explorant les profondeurs des cavernes pouvaient littéralement voir les animaux sortir de la roche et prendre vie à la lumière dansante de leurs torches. Au point qu’on peut se demander si le phénomène de la paréidolie était activé par la présence du mythe de l’émergence dans l’esprit des humains, ou si c’est la surprenante apparition des animaux dans les aspérités de la roche qui est à la source du mythe de l’émergence…
*
Mais qui étaient les auteurs de ces images ? Femmes, hommes, enfants ? Dotés de capacités cognitives spéciales ? Investis d'un rôle particulier au sein du groupe ? Travaillant seuls ou de manière collective ?
Rien ne permet de le dire. Tous
les cas de figure restent possibles.
Hormis les visions romantiques et patriarcales qui
transforment la grotte de Lascaux en un atelier d'artiste de la Renaissance dans lequel les hommes peignent les images, tandis que les femmes, leurs petites mains, préparent les pigments...
Mais ce qu'on peut avancer, compte tenu de la qualité plastique des images produites par les chasseurs-cueilleurs du paléolithique, c'est qu'en s'enfonçant dans les cavernes, ils ont été – comme le déclare Max Ernst à propos de ses frottages surréalistes – "surpris par l'intensification subite de [leurs] facultés visionnaires".
Ce qui leur a permis de transfigurer les configurations géologiques des cavernes en des "instruments esthétiques" dont le pouvoir de fascination s'exerce encore sur nous.
Sources principales
Alain Berthoz, Le sens du mouvement, Odile Jacob, 1997, 2013
Bertrand David et Jean-Jacques Lefrère, La plus vieille énigme de l'humanité, Fayard, 2013 Julien d’Huy, Cosmogonies, La préhistoire des mythes, La découverte, 2020
Jean-Loïc Le Quellec, La caverne originelle, La Découverte, 2022
En ligne
Hominidés : site très riche sur la préhistoire et notamment les différentes hypothèses concernant les peintures pariétales