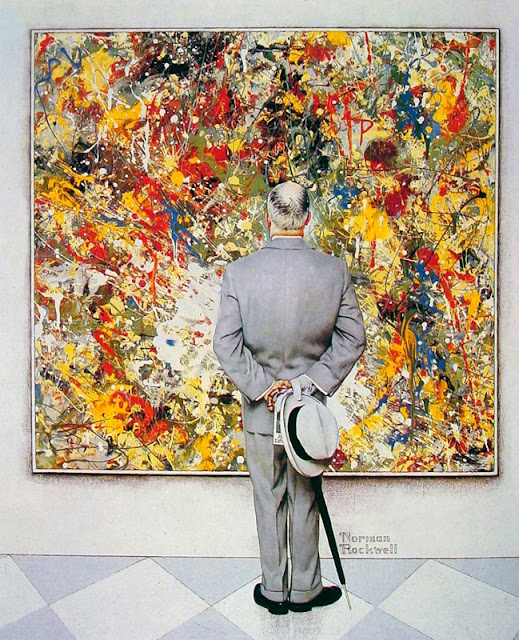L'invention des femmes
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? Dans un essai publié en 1971, l’historienne Linda Nochlin explique comment le monde des Beaux-Arts, jusqu’au vingtième siècle, s’est accordé pour exclure presque totalement les femmes et, simultanément, a tout fait pour dévaluer le talent des quelques rares qui étaient parvenues à s’y faufiler, comme Artemisia Gentileschi, Élisabeth-Louise Vigée Le Brun ou Rosa Bonheur.
 |
| Artemisia Gentileschi, "Judith et sa servante", 1619. |
 |
| Louise Élisabeth Vigée Le Brun, "Autoportrait", 1790. |
 |
| Rosa Bonheur, "Cheval blanc", 1866. |
*
Pour contourner cette mise à l’écart, souvent intériorisée par les femmes elles-mêmes, certaines d’entre elles ont camouflé leur énergie créatrice derrière l’alibi du spiritisme, justifiant leur production par le fait qu’elles n’étaient que les interprètes d’esprits immatériels guidant leur main.
Dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et au début du vingtième, elles ont ainsi produit des œuvres étonnantes, largement en avance sur l’évolution de l’art établi et, parfois, source d’inspiration pour les avant-gardes.
À
côté de Georgiana Houghton, Jeanne Tripier ou Madge Gill, le cas de
Hilma af Klint est particulièrement remarquable. Issue d’une famille
d’officiers et d’ingénieurs de la marine suédoise, elle est, dans les
années 1880, l’une des rares femmes à faire des études supérieures et à
intégrer l’académie des beaux-arts de Stockholm.
Sa
production officielle reste extrêmement académique mais, en parallèle,
elle s’intéresse au spiritisme et à la théosophie. Sous l’influence des "Maîtres" – des esprits qui l’ont choisie pour créer les images du "Temple" – elle entreprend plusieurs séries de très grandes peintures
abstraites, et cela même avant que Kandinsky n’ouvre cette voie à l’art
moderne.
Mais la pression sociale est telle que Hilma af Klint ne rendra jamais publique cette production et demandera à ses héritiers d’attendre vingt ans après sa mort pour la révéler.
Mais la pression sociale est telle que Hilma af Klint ne rendra jamais publique cette production et demandera à ses héritiers d’attendre vingt ans après sa mort pour la révéler.
 |
| Hilma af Klint, panneaux du retable pour le "Temple", vers 1907. |
Ces quelques exemples nous montrent, s'il en était besoin, qu’en matière d’inventions visuelles, les femmes ne sont pas en reste sur les hommes. La rareté et la discrétion de leur production n’est que le résultat d’une mise à l’écart délibérée par le « système éducationnel et institutionnel du monde de l’art ».
*
Dans la majorité des sociétés pré-industrielles, il existe une stricte division des activités par genre. Au sein d’une même culture, il est extrêmement rare que les femmes et les hommes exercent les mêmes tâches et produisent le même type de biens.
Chez les chasseurs-collecteurs, où la hiérarchie sociale est quasiment inexistante, les activités requérant une capacité d’invention sont, en général, équitablement partagées entre les hommes et les femmes. C’est le cas, par exemple, chez les Indiens d’Amazonie où les hommes fabriquent les parures de plumes, tandis que les femmes réalisent les peintures corporelles.
 |
| Peintures corporelles Kaxinawa, Amazonie, photo Deep Forest Foundation, début 21° siècle. |
Ou,
encore, dans l’ancienne civilisation de Thulé où les hommes se
dédiaient à la sculpture des bois de cervidés et les femmes à celle de
l’ivoire.
Dans
de nombreuses sociétés sédentaires africaines, si le gros-œuvre de l'habitat est réalisé par les hommes, ce sont les femmes qui se chargent des motifs
qui couvrent les murs, tant extérieurs qu'intérieurs. Des motifs qui ne
sont pas qu'une simple décoration puisque leur symbolique permet
d'intégrer la demeure à la vision du monde par laquelle se définissent
ces peuples.
Dans le même registre, la tradition de peintures éphémères sur le sol et les murs est encore très présente dans les communautés autochtones de l'Inde rurale. Elles sont réalisées par les femmes à l'occasion de fêtes religieuses, et leurs motifs sont destinés à protéger la maison et la communauté.
 |
 |
| Réalisation de peintures murales pour la fête de Sohrai, Inde, photos C. Jumel, 2023. |
Quant aux nomades, dans de très nombreuses sociétés, ce sont les femmes qui ont la charge et, souvent, la "propriété" de l’habitat, que ce soient les tentes, transportées lors des déplacements, ou les huttes, reconstruites à chaque étape.
Or, ces constructions sont loin d’être de précaires abris, comme on le pense souvent. Non seulement elles dessinent une version domestique du monde, chaque élément étant investi d'une forte valeur symbolique mais, en modulant les flux bioclimatiques avec une remarquable économie de moyens, elles ont permis à l’être humain de s’adapter aux climats les plus rudes de la planète. Les femmes des sociétés nomades sont probablement les premières bâtisseuses, bien avant que l'architecture monumentale, expression visuelle du pouvoir despotique masculin, ne se développe au néolithique.
 |
| Groupe de femmes Blackfeet assemblant les peaux de bison pour le revêtement d'un tipi, plaque de lanterne magique d'après W. McClintock, vers 1900. |
 |
| Tissage des lais du revêtement de la tente noire, Proche-Orient, photo E. & E. Matson, 1898. |
En
ce qui concerne la préparation des rituels d'initiation, chaque sexe se
charge, en général, de la réalisation des parures utilisées dans les cérémonies
spécifiques.
Par contre, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs et d'éleveurs itinérants, où les rapports au monde des esprits sont pris en charge par des chamanes, ce sont aussi bien des femmes que des hommes qui exercent cette "activité" au travers de rituels divinatoires et thérapeutiques, véritables performances multimédia associant danse, musique et incantations poétiques.
*
Mais dans toute les sociétés, même celles au pouvoir patriarcal le plus affirmé et malgré la lourde domination que les hommes exercent sur les femmes, ceux-ci ne peuvent empêcher les femmes d’exprimer leur inventivité. Si on ne le remarque pas, cela tient au fait que, dans ces sociétés – monde occidental inclus – les activités des uns sont survalorisées, alors que celles des unes sont systématiquement dévaluées. Les hommes se réservent les domaines d’exception, ou définissent comme tels ceux qu’ils investissent (pouvoir, prestige, sacré), tandis qu’ils assignent les femmes aux activités dépréciées de la sphère domestique et du quotidien.
Et, lorsqu’on commence à explorer les territoires immenses des peintures corporelles et des tatouages, des travaux de perlage, de vannerie, de poterie, de tissage et de broderie, on est pris de vertige, tant est vaste la palette de l’inventivité déployée par les femmes dans la réalisation de ces instruments esthétiques.
 |
| Paniers en vannerie, Thaïlande, 20° siècle. |
 |
| Vêtement Cheyenne décoré de motifs en épines de porc-épic tressées, Amérique du Nord, 19° siècle |
 |
| Face antérieure d'un très grand sac à provisions de nomades turkmènes, début 20° siècle. |
On
découvre également que certains de ces travaux, non seulement
soutiennent aisément la comparaison avec les "chefs-d’œuvre" de l’art
occidental, mais que, parfois, ils les ont largement devancés et
peut-être même influencés.
 |
| Textile Kuba en fibres de rafia, Congo, 20° siècle. |
 |
| Manteau de travail rapiécé selon la technique du "boro", Japon, début 20° siècle. |
C’est
le cas des innombrables motifs de textiles inventés par les femmes de
par le monde, notamment ceux qui utilisent la technique du patchwork.
Ainsi ces couvertures fabriquées, au dix-neuvième siècle, par les femmes
des fermiers du Middle-West américain, qui évoquent les peintures
abstraites de Paul Klee et devancent ses recherches picturales de plus
d’un demi-siècle.
*
Non, s'il n’y a pas eu de "grands artistes femmes", il y a eu des millions, des dizaines, des centaines de millions d’inventeurs de formes – ou plus justement d'inventrices – qui sont des femmes. Il suffit de nous débarrasser de nos biais culturels pour le constater.
Sources :
Linda Nochlin, Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? Thames & Hudson, 2021.
Alain Testart, L'amazone et la cuisinière, anthropologie de la division sexuelle du travail, Gallimard, 2014.
Labelle Prussin, African nomadic architecture, space, place and gender, Smithsonian Institution Press, 1995.
Chantal Jumel, Kolam, Kalam, Alpona, Mandana, peintures rituelles éphémères de l'Inde et d'ailleurs, articles en ligne.